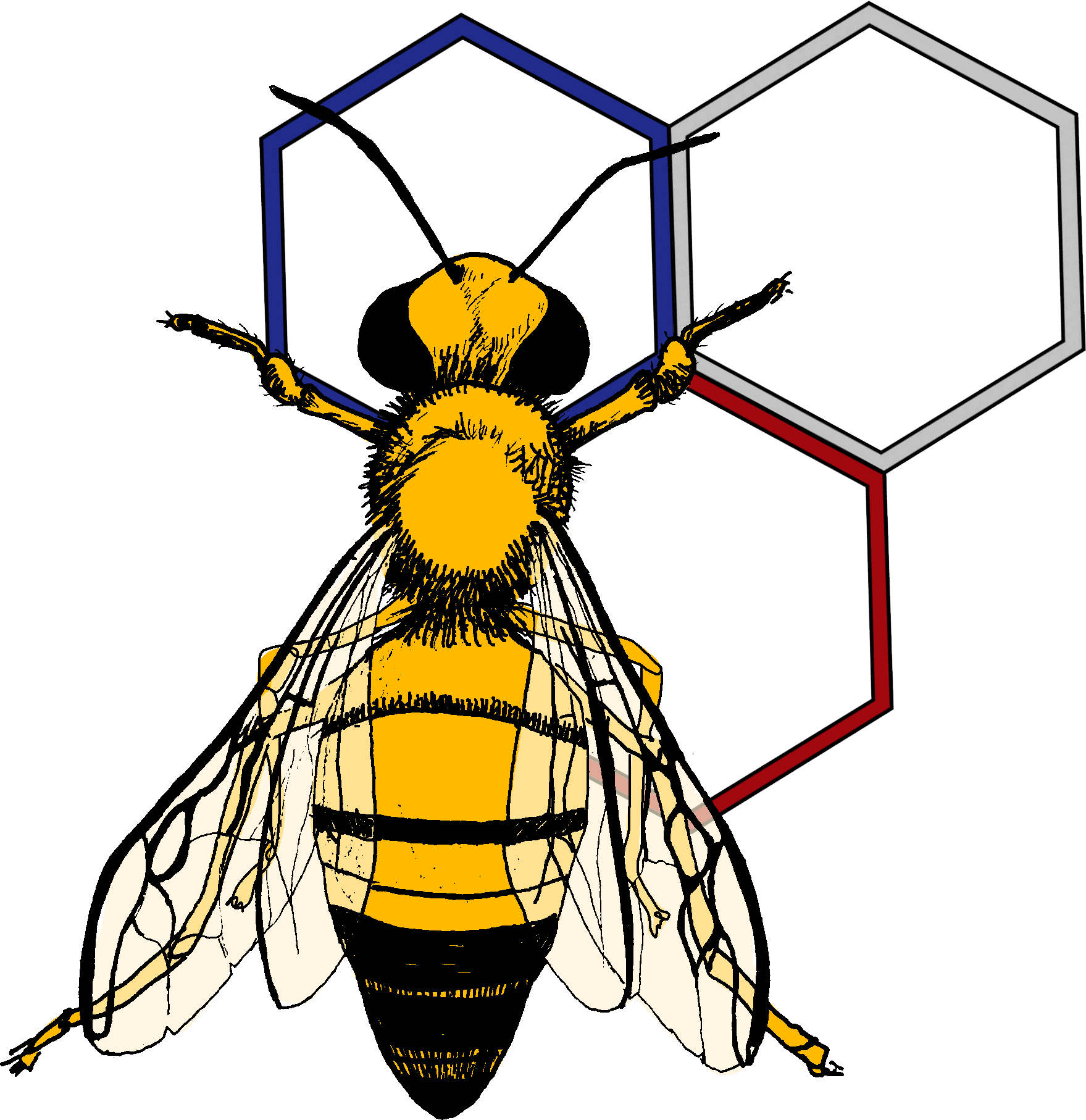AUX SOURCES DU SCANDALE URAMIN
Championne mondiale du nucléaire, Areva peine à sortir de la tourmente. Aux inquiétudes sur l’avenir de la filière depuis l’accident de Fukushima s’ajoutent les retards des réacteurs de troisième génération en Finlande et à Flamanville. Mais, surtout, l’entreprise publique française est mise en cause pour des investissements suspects dans trois gisements d’uranium africains.
C’est une fine rivière rouge sang qui traverse un empire de verdure. Cent trente-quatre kilomètres de piste oubliés de la modernité et du monde. Tracée en toute hâte il y a cinq ans par d’immenses machines, la route en latérite brûlante relie Bangassou à Bakouma, en République centrafricaine. Elle devait apporter la prospérité à tout le pays — l’un des plus pauvres du monde —, la fortune à ses travailleurs, et de l’énergie pour un siècle à la France. On lui avait promis qu’elle deviendrait l’aorte d’un Nouveau Monde, conçu en toute hâte entre l’Afrique du Sud, Toronto, Paris et les îles Vierges. Aujourd’hui dévorée par une végétation féroce et insatiable, criblée de crevasses, colonisée par les papillons et les fourmis rouges, elle ne nourrit plus que le silence — et l’un des plus grands scandales industriels du siècle naissant.
On accède à Bakouma depuis Bangui, la capitale. Après deux jours de voyage au milieu de la misère et des groupes armés, il faut encore passer quelques heures sur une motocyclette sujette aux pannes. Une chaussée toujours plus étroite, les branches, l’humidité et un soleil de plomb forcent en définitive à mettre pied à terre pour traverser les derniers fleuves, rivières et ruisseaux qui nourrissent la forêt vierge de la préfecture de Bangassou. Enfin apparaît un ensemble de cases faites de la même terre que le sol, aux toits couverts de branches sèches et aux intérieurs garnis de lits sans matelas. Un lieu sans odeur ni couleur particulière, que le soleil habite de 6 heures du matin à 6 heures du soir toute l’année ; un lieu dont l’autarcie est régulièrement rompue par un flot d’étranges pèlerins arrivant les yeux pleins de lucre et repartant toujours asséchés, repoussés par le poison doré qu’ils recherchaient. Un lieu encerclé par un minerai qui avait promis à l’Occident l’éternité et qui prend chaque jour un peu plus la forme de son ultime malédiction : l’uranium. Ces cases abritent les secrets de l’effondrement du plus grand groupe nucléaire du monde : Areva.
Huit millions de dollars versés au Trésor centrafricain
En 2007, le groupe français avait racheté l’entreprise UraMin, détentrice depuis l’année précédente des droits miniers de Bakouma (voir « De promesses en abandon »). La « découverte » (lire « Une mine connue de longue date ») d’immenses gisements d’uranium dans l’est de la Centrafrique avait suscité de tels espoirs que le général François Bozizé, qui présidait alors aux destinées du pays, exigea d’Areva la construction d’une centrale nucléaire près d’un village où n’étaient encore arrivés ni l’eau potable, ni l’électricité, ni le téléphone. Les dirigeants du groupe préférèrent montrer les plans d’écoles, de stades et d’hôpitaux qu’ils s’apprêtaient — disaient-ils — à construire dans la région pour un montant qui aurait dû atteindre le milliard d’euros.
Assorti d’importants bonus financiers, l’accord signé le 10 août 2008 permit le décaissage un mois plus tard de 8 millions de dollars versés au Trésor centrafricain, en provenance des fonds spéciaux de l’entreprise française. Les voitures, avions et engins de construction géants envahirent peu après une capitale habituée au rythme précautionneux et engourdi des trafiquants de diamants. Un peu plus de cent employés furent recrutés à travers le pays, l’université de Bangui fut mobilisée pour former des géologues et des topographes. Le « général » lui-même se rendit en mars 2011 dans le petit village de Bakouma pour annoncer l’arrivée des temps glorieux.

L’étrange rêve qu’avait fait naître Areva a rapidement pris l’allure d’un des cauchemars habituels de la mondialisation. À Bakouma, les premiers salaires frôlaient à peine les 70 euros par mois, pour des journées de treize heures, sept jours par semaine, « sans pause déjeuner », précise M. Sylvain Ngueké, un ancien foreur : « Nous n’avions droit qu’à un jour de repos toutes les deux semaines, passé sur le site minier lui-même, sous une chaleur intense et soumis à ces rayonnements radioactifs permanents. » Le cadre centrafricain le mieux rémunéré, le directeur adjoint du site, touchait « 700 000 francs CFA [environ 1 050 euros] par mois », indique un autre ancien membre du personnel, qui lutte depuis trois ans à Bangui pour obtenir des indemnités de licenciement.
Huit ans et une guerre civile plus tard, M. Bozizé est parti en exil, le gisement de Bakouma a été abandonné, l’espérance de vie ne dépasse toujours pas 50 ans dans le pays et le produit intérieur brut par habitant, 350 dollars. Les routes, les hôpitaux et les écoles promis n’ont jamais été construits. Le ventre gonflé, des dizaines d’enfants souffrant de malnutrition sévère hantent les cases en terre cuite d’un village qui n’avait jamais connu la faim et qui vient de perdre son dernier médecin. L’électricité, l’eau potable et le réseau téléphonique, qui y avaient brièvement fait leur apparition, ont complètement disparu.



Le basculement est intervenu en 2012, à la veille de l’élection présidentielle française. Comme tous les premiers dimanches du mois, après avoir pris une avionnette pour parcourir les huit cents kilomètres qui séparent Bakouma de la capitale du pays, M. Gianfranco Tantardini, dit « le géant », se rend à la messe de la paroisse. Ancien officier de marine italien naturalisé français, ce colosse au crâne rasé d’une cinquantaine d’années, qui fume cigarette sur cigarette, a commandé entre 2002 et 2004 un sous-marin nucléaire d’attaque. Il entre dans l’église financée par l’Opus Dei espagnol, s’installe sur une banquette en bois sans dossier, entouré de ses ouvriers et de leurs familles, et suit pieusement la cérémonie.
La maire de Bakouma, Mme Eugénie Damaris Nakité Voukoulé, se souvient parfaitement de ce grand homme munzu — blanc — qui a dirigé en 2011 et 2012 le site minier de son village. Celui-ci employait 133 personnes, dont 127 Centrafricains. Elle se souvient surtout de ce jour où, à l’issue de la messe, M. Tantardini a réuni l’ensemble des personnels du site pour leur annoncer, après un long silence, que Bakouma serait « mis en sommeil ». Peu après le rachat d’UraMin par Areva, ses représentants avaient promis aux employés cinquante ans de travail, et leur avaient fait signer des contrats qui prévoyaient augmentations et primes régulières.
« Bip, bip, bipbipbipbip… » Le compteur Geiger crépite. À travers les hautes herbes, les chemises se détrempent et la respiration devient difficile. 35, 36, 37… 40 degrés. Le camp minier de Bakouma ressemble au no man’s land de Stalker, le film d’Andreï Tarkovski : un espace maudit où verdure, ruines et rouille se mêlent en un amas de moins en moins différencié. Quarante ans d’expéditions faillies et de relations françafricaines se concentrent dans cette immense cuvette radioactive où une épaisse couche de boue et de feuillages a déjà recouvert les constructions abandonnées il y a moins de quatre ans. À terre gisent des centaines de boîtes en plastique qui ont servi au stockage d’échantillons de minerai, tandis que, quelques mètres plus loin, des sacs hermétiques en aluminium jonchent le sol. Utilisés pour transporter des morceaux de minerai radioactifs, ils n’ont jamais été évacués par Areva et sont aujourd’hui tous éventrés : « Les Peuls les ont probablement confondus avec des sachets d’alimentation », nous dit un ancien foreur ayant travaillé sur place.

Des opérations aussi délicates et essentielles que l’enfouissement des déchets radioactifs, la décontamination des infrastructures et la sécurisation d’un site qui pourrait se révéler fatal pour les populations environnantes n’ont jamais été menées. En violation des règles les plus élémentaires, aucun panneau d’avertissement, aucune barrière n’en interdit l’accès. Lorsqu’on s’aventure sur le principal gisement, les rayonnements sont omniprésents. Au-dessus de déchets radioactifs abandonnés tels quels au milieu des champs, entre une petite plantation de maïs et un troupeau de zébus, les doses mesurées représentent quarante fois l’irradiation naturelle de la région (1) et dix-sept fois les doses maximales autorisées en France pour les employés du nucléaire. Les infrastructures sanitaires ont été complètement démantelées avec le départ des derniers expatriés, et les fichiers médicaux des employés locaux ont disparu. Aucun suivi n’a été mis en place.
À quelques milliers de kilomètres de là, Areva, société anonyme propriété de l’État français, a annoncé en mars 2015 des pertes de 4,8 milliards d’euros et doit engager une restructuration qui impliquera la suppression de six mille emplois. L’État a dû participer à une recapitalisation de 5 milliards d’euros pour restaurer son bilan, tandis que son activité « réacteurs » doit être complètement cédée à EDF d’ici à 2017. Le scandale industriel du siècle et les sommes astronomiques qu’il charrie semblent à des années-lumière de ce petit village centrafricain. Comment comprendre qu’Areva ait dépensé plusieurs milliards d’euros pour l’achat de trois mines fantômes en Namibie (Trekkopje), en Afrique du Sud (Ryst Kuil) et en Centrafrique (Bakouma), avant de les fermer précipitamment sans en avoir tiré un gramme de minerai ? Quatre milliards d’euros de pertes sèches inscrites dans les comptes de l’entreprise publique, soit l’équivalent de vingt années de budget de l’État centrafricain…
Racheté au plus fort de la course à l’uranium
Lorsque Mme Voukoulé, qui, à 70 ans passés, travaille encore quotidiennement aux champs, se voit expliquer l’affaire, elle demande à trois reprises qu’on lui répète les montants en jeu. Elle rappelle qu’elle a dû se battre pendant deux ans afin d’obtenir d’Areva 100 000 francs CFA (200 euros) pour le seul investissement qui soit resté dans le village : la rénovation de sa mairie. Les 400 000 euros de dépenses sociales et sanitaires promis, soit moins de 0,5 % de l’argent théoriquement investi dans le site et 0,01 % du coût global de l’opération, ne sont aujourd’hui visibles nulle part. « La seule activité sociale qu’organisait Areva, c’étaient les barbecues du chef du camp avec ses amis expatriés un week-end par mois », lance, amer, un villageois.
Areva présente aujourd’hui sur son site Internet les raisons de son départ de Bakouma de façon lapidaire : « En raison du faible coût de l’uranium depuis Fukushima et de l’insécurité présente dans le pays depuis plusieurs mois, Areva a annoncé en septembre 2012 la suspension de l’exploitation minière de Bakouma, en République centrafricaine. » Ce gisement a en effet été racheté au plus fort de la course à l’uranium. Les prix spot — d’achat immédiat — atteignaient alors leur plus haut niveau. Mais ils ne reflétaient pas la réalité d’un marché déterminé essentiellement par les contrats de long terme, dont les variations ont été relativement faibles pendant la période concernée. Le démantèlement du site avait d’ailleurs commencé bien avant l’accident nucléaire de Fukushima, et peu avant que l’entreprise investisse dans d’autres mines, notamment en Mongolie et dans l’immense exploitation de Cigar Lake, au Canada. « En réalité, aucun matériel d’exploitation n’a jamais été amené sur le site, confie un cadre de l’entreprise, sur place à l’époque des faits. Nous sentions dès 2009 que l’exploitation n’aurait jamais lieu. » Soit deux ans avant Fukushima…

L’argument sécuritaire paraît plus faible encore, dans la mesure où la situation ne s’est dégradée sérieusement qu’un an et demi plus tard. La communication d’Areva mentionne une attaque contre le site minier en date du 24 juin 2012. Des habitants de Bakouma racontent avoir vu ce jour-là le chef du camp accompagner des rebelles jusqu’au gisement. « Il leur a dit de “piller” ce qu’ils souhaitaient et a demandé au groupe de sécurité Fox de ne pas tirer », raconte un géologue sous couvert d’anonymat. « Quand on parlait de l’attaque avec les gars d’Areva, c’était toujours avec un demi-sourire », ajoute un expatrié sous-traitant de l’entreprise en Centrafrique. Fantasmes ? Peu avant les faits, M. Tantardini avait en tout cas ordonné l’évacuation de tous les documents sensibles, ainsi que des personnels qualifiés. Car, loin des simples considérations industrielles ou énergétiques, la mine de Bakouma recouvre un scandale majeur, qui alimente la chronique politico-judiciaire française depuis maintenant trois ans : l’affaire UraMin.
Fondée en 2005 par MM. Stephen Dattels et James Mellon avec 100 000 dollars (91 000 euros) de mise de départ (2), la société UraMin investit rapidement dans trois mines, en Afrique du Sud, en Namibie et en Centrafrique, où elle prospecte intensément pour se doter d’un bilan flatteur. Valorisée à 300 000 dollars en mars 2005 et détenant 150 millions de dollars d’actifs début 2007 — dont moins de 50 millions d’actifs miniers —, UraMin est rachetée par Areva en juin 2007 pour rien de moins que 2,5 milliards de dollars (alors 1,86 milliard d’euros). Cette opération fait étrangement écho au destin qu’ont connu trois autres entreprises de M. Dattels, reprises par de grands groupes d’État pour des sommes tout aussi faramineuses avant de rapidement disparaître des comptes et des radars. Son entreprise principale, Oriel Resources PLC, dont la valorisation s’est accrue elle aussi de 60 % dans les mois ayant précédé son rachat par le groupe russe Mechel, est mentionnée dans les « Panama papers » en tant que copropriétaire d’une entité située dans un paradis fiscal.
Loin d’avoir été échaudée par l’échec d’UraMin, Areva perdra à nouveau plusieurs centaines de millions d’euros, en 2010, lors du rachat des parts de M. Dattels dans Marenica Energy, propriétaire d’une mine jamais exploitée en Namibie, puis dans le rachat par Eramet, alors filiale d’Areva, de la mine de nickel fantôme de Weda Bay, en Indonésie, pour 270 millions de dollars canadiens (198 millions d’euros). Cette dernière, officiellement « mise en sommeil », n’a jamais été exploitée.
Areva, une excroissance de l’état français
Comment expliquer une telle succession de transactions ruineuses ? Selon le Mail & Guardian (3) de Johannesburg, Areva aurait racheté UraMin à un prix largement surévalué pour qu’une partie de la transaction permette de verser plusieurs centaines de millions d’euros de commission au clan du président sud-africain d’alors, M. Thabo Mbeki. En échange, Areva espérait gagner un appel d’offres pour plusieurs centrales nucléaires et une usine d’enrichissement de l’uranium — une hypothèse reprise par d’autres sources. Un ancien ministre des mines centrafricain nourrit le même soupçon de rétrocommissions en ce qui concerne Bakouma : « Nous avons rapidement pensé qu’Areva avait utilisé UraMin comme couverture. Tout le monde savait en tout cas qu’UraMin n’était que de passage, pour servir de tête de pont à une grande entreprise nucléaire. »
Ancien inspecteur des impôts, il est devenu, après son passage au ministère, le détenteur d’un 4 x 4 avec chauffeur et de plusieurs propriétés en France, financées grâce aux « bonus » attribués par les entreprises minières. Il nous reçoit dans le seul hôtel cinq étoiles de la capitale centrafricaine, où la chambre lui coûte chaque jour l’équivalent d’une année du revenu moyen de ses concitoyens. « Ces affaires étaient traitées directement par la présidence, mais l’information circulait. Lorsque l’appel d’offres pour le gisement de Bakouma a été rendu public, Areva a fait une proposition ridicule, qui nous a forcés à accepter celle d’UraMin. Puis ils ont saisi l’occasion pour effectuer des malversations en survalorisant le permis lors du rachat d’UraMin. »

Areva n’est pas n’importe quelle entreprise. Soupçonnée de corruption et de graves négligences sanitaires et environnementales dans des pays aussi divers que la Chine, l’Afrique du Sud, le Niger, l’Allemagne, la Namibie ou encore le Gabon, elle est une excroissance de l’État français, son principal actionnaire via le Commissariat à l’énergie atomique. Ses activités dans le nucléaire civil et militaire français, partiellement couvertes par le secret défense, ont fait l’objet d’une réorganisation accélérée à l’orée des années 2000, sous la direction de Mme Anne Lauvergeon, ancienne secrétaire adjointe de la présidence de la République sous François Mitterrand. Appartenant au corps le plus puissant de la République, les X-Mines, dont elle a animé le réseau d’anciens, Mme Lauvergeon manifeste un entregent politique transversal : le président Nicolas Sarkozy lui a proposé le ministère de l’enseignement supérieur en 2007, avant que M. François Hollande n’envisage de la nommer à son tour au gouvernement en 2012.
À la tête d’Areva, elle demande et obtient des marges de manœuvre exceptionnelles, qui lui permettent de court-circuiter la tutelle des autorités de contrôle de l’État et d’engager des chantiers pharaoniques qui mèneront à l’effondrement de l’entreprise. Ainsi, tant le rachat que l’abandon des gisements d’UraMin ont eu lieu sous la supervision directe du ministre de l’économie de l’époque, M. Thierry Breton, puis de l’Élysée, à travers un homme, M. Patrick Balkany, alors député et maire de Levallois. Ce dernier est intervenu en 2008 pour calmer la colère du président centrafricain : « Bozizé a senti la trahison, nous raconte un haut fonctionnaire en poste à l’époque. Il a tout de suite compris ce qui se tramait et a bloqué l’exploitation de la mine de Bakouma, menaçant de faire annuler les permis et de les remettre en jeu. » Selon une plainte de l’État centrafricain, qui a saisi le parquet centrafricain, M. Balkany a touché une commission de 5 millions d’euros pour ses services, qui ont permis de résoudre le conflit.
Pourquoi le groupe Areva a-t-il décidé de payer au moins trente fois sa valeur pour le gisement qu’il connaissait peut-être le mieux au monde, d’y investir — affirment ses services — près de 100 millions d’euros, de mobiliser le ban et l’arrière-ban de la politique française pour en assurer l’exploitation, avant de tout simplement l’abandonner aux mauvaises herbes ? L’incapacité du groupe à donner une explication claire a amené certaines personnes, dont le spécialiste minier Vincent Crouzet, l’enquêteur Marc Eichinger, WikiLeaks (4) ou encore l’intermédiaire Saïf Durbar, à affirmer que le rachat d’UraMin pourrait avoir eu pour seul but de mettre en œuvre un immense système de rétrocommissions alimentant in fine la France.
M. Durbar, qui avait été nommé vice-ministre par M. Bozizé, a été auditionné le 2 juillet 2015 par le juge Renaud Van Ruymbeke. Arrêté et condamné à trois ans de prison ferme en France pour une affaire d’escroquerie, il avait été étrangement libéré trois mois plus tard, après ce qu’il affirme être un accord avec les services de renseignement (5). Alors que son nom apparaît plusieurs centaines de fois dans les articles relatifs à l’affaire UraMin, Mme Éliane Houlette, qui dirige le parquet national financier, nous assurera lors de deux entretiens consécutifs n’avoir « jamais entendu parler de lui ». Ce même parquet qui, après des mois d’attentisme, a dû se résoudre en mars 2015 à ouvrir deux informations judiciaires pour escroquerie, corruption d’agent public étranger et abus de pouvoir, diffusion de fausses informations et présentation de comptes inexacts.

Areva s’est contentée de nous transmettre un communiqué de presse dans lequel l’entreprise prétend avoir obtenu un « quitus » de la part de l’État centrafricain, alors que des documents exhumés par WikiLeaks et par notre enquête tendent à démontrer le contraire (6). Boris Heger et Étienne Huver, journalistes du collectif Slug News travaillant sur le sujet, ont fait l’objet de menaces provenant du cabinet du ministre de la défense (7). Mme Lauvergeon a poursuivi en justice son ancien directeur des mines, M. Sébastien de Montessus, après qu’un consultant spécialisé et un détective privé (8) eurent été payés par Areva pour espionner la présidente de l’entreprise.
En Centrafrique, toutes les archives relatives à UraMin et à la présence d’Areva sur le territoire ont mystérieusement disparu après que la milice Seleka eut chassé M. Bozizé du pouvoir, en mars 2013, avec l’assentiment tacite de la France. Le jour même de l’arrivée au pouvoir des milices, le directeur général des mines du pays voyait sa maison fouillée de fond en comble, puis saccagée. Avant le départ en catastrophe d’Areva, et alors qu’une mission d’enquête de l’État centrafricain était en chemin vers Bakouma, M. Tantardini aurait, selon un géologue alors sur place, rappelé à ses collaborateurs la nécessité de « bien vider leurs corbeilles », avant de reformater l’ensemble des disques durs restés sur le site minier et de mettre sous clé le serveur, puis d’évacuer par avion l’ensemble des archives du groupe. Depuis, ce personnage-clé a obtenu une belle promotion à la tête de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, dont il supervise le redressement judiciaire.
L’État centrafricain lui-même ne dispose plus d’une seule copie d’un document relatif à Areva, ce qui rend difficile toute poursuite locale contre le groupe français. M. Joseph Agbo, l’actuel ministre des mines, dit son « impuissance complète » sur ce dossier, qu’il a tenté de réactiver plusieurs fois sans jamais réussir à entrer en contact avec le groupe français, si ce n’est via un « notaire banguissois qui les représente ici » et qui se montre peu disert. Les travailleurs centrafricains ont bien tenté, malgré tout, de lancer une procédure judiciaire contre Areva à Bangui, qu’ils disent encore en cours. Las, le procureur de la République centrafricaine, M. Ghislain Grésenguet, dit « ne jamais en avoir entendu parler ».
Aucun protagoniste français de l’affaire n’a accepté de répondre à nos questions. Mme Lauvergeon n’a accordé que deux entretiens depuis sa mise en examen. Au Parisien, elle a affirmé que l’acquisition d’UraMin s’était faite « avec le feu vert de toutes les tutelles et de l’État », tandis que les dépréciations d’actifs auraient « scrupuleusement » respecté les normes comptables (30 mars 2016). Sur France 3 (9), elle a présenté son éviction comme une conséquence de son opposition à deux projets de M. Sarkozy : la privatisation de la branche mines au profit d’intérêts qataris et la vente d’une centrale nucléaire à la Libye de Mouammar Kadhafi. Elle assure aussi n’avoir jamais parlé du rachat d’UraMin à son mari Olivier Fric. Ce dernier, impliqué dans l’opération, est mis en examen pour délit d’initié. Il est soupçonné d’avoir spéculé sur le titre de l’entreprise à travers la société Vigici, sise à Lausanne, la veille de sa prise de contrôle par Areva. Il en aurait tiré un bénéfice de 300 000 euros.
Lors de l’arrivée d’Areva, un Sud-Africain prénommé Michael, directeur du site de Bakouma alors qu’il appartenait encore à UraMin, avait réuni les employés à l’entrée du camp pour leur annoncer, avec un mélange de fatalisme et de grandiloquence entrepreneuriale : « UraMin, c’est terminé. Nous étions un chien qui aboie mais ne mange pas. Demain viendra peut-être un chien qui aboie et qui mange… »
(1) Elles atteignent les 3 micro-sieverts par heure (μSv/h), alors qu’elles ne dépassent pas autour du village 0,08 μSv/h.
(2) « Jim Mellon interview », Spear’s WMS Magazine, no 13, février 2010.
(3) « French nuclear frontrunner’s toxic political dealings in SA », Mail & Guardian, Johannesburg, 3 août 2012.
(4) Cf. « La nouvelle guerre sale pour l’uranium et les minerais d’Afrique », dossier de WikiLeaks, 5 février 2016, et le roman d’espionnage de Vincent Crouzet Radioactif, Belfond, Paris, 2014.
(5) « Areva, 3 milliards en fumée », « Pièces à conviction » du 10 décembre 2014, sur France 3.
(6) « Rapport d’activité sur la mine de Bakouma et Areva », WikiLeaks, 5 février 2016.
(7) « Areva & UraMin, la bombe à retardement du nucléaire français », Arte, 14 mai 2015.
(8) MM. Marc Eichinger et Mario Brero.
(9) « Areva : les secrets d’une faillite », « Pièces à conviction » du 19 octobre 2016, sur France 3.
Lire aussi les courrier des lecteurs dans nos éditions de novembre 2016 et de janvier 2017.