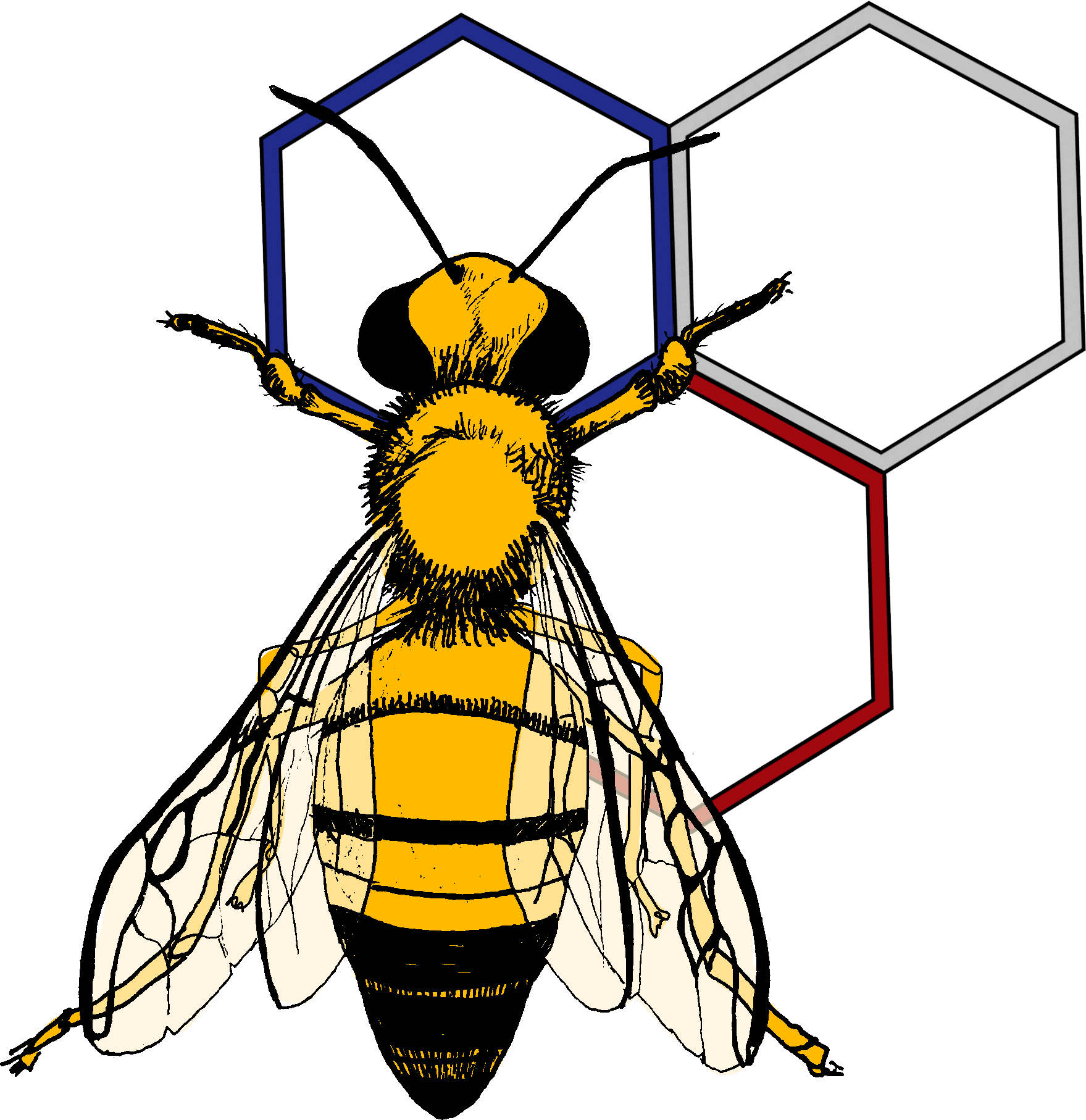CENTRAFRIQUE, LA DÉROUTE DES NATIONS UNIES
Depuis deux jours, une opération militaire menée par la MINUSCA sème cependant le trouble dans le poumon commercial du pays, qui vit anxieux dans la crainte d’une reprise des représailles. Les raids sont devenus quotidiens, les distributions de cadavres aussi, et la mémoire des camions emplis de réfugiés partant vers le Tchad, harcelés par les anti-balaka dans le silence des autorités, a resurgi. La cible des opérations de l’ONU, Nimery Matar, alias Force, un milicien à qui les casques bleus avaient fixé un ultimatum au 30 mars, reste introuvable. Chargé avec deux autres groupes de la collecte et de la répartition des impôts dans le quartier musulman, à la tête d’une centaine de jeunes désœuvrés, Force est en lien direct avec les grands chefs du Nord et de l’Est du pays qui prirent la capitale en 2013, et qui menacent régulièrement de redescendre sur Bangui. Ici, nulle force centrafricaine n’entre sans son autorisation, et les organisations humanitaires ont toutes été évacuées. Alors qu’il a échappé aux premières opérations menées par les casques bleus portugais, il ne cesse de surenchérir en menaçant de représailles, et apparaît désormais comme une entaille à la crédibilité de forces internationales déjà largement décriées.
La veille encore, des tirs ont été entendus toute la nuit, et la paranoïa se mêle aux réminiscences traumatiques des massacres commis il y a quelques années. Cela fait deux jours qu’affluent les cadavres au sein des dispensaires de la Croix Rouge centrafricaine et de Médecins sans frontières. Alors que la rumeur se mêle aux intérêts, une manifestation est organisée et enserre le commissariat qui vient d’être installé par les forces armées nationales (FACA). Celles-ci viennent à peine de prendre pied dans ce qui était jusqu’alors demeuré un no man’s land. Il ne faut cependant pas un instant pour que les forces formées par l’Union Européenne, accompagnées de membres de la division Wagner dépêchées par la Russie, et de casques bleus rwandais, tirent sur la foule. La population se réfugie près de la mosquée, des hommes de Force se mêlent aux manifestants pour répliquer, et le contingent onusien, composé d’une vingtaine de soldats rwandais et de deux blindés, se trouve pris entre les feux. Alors que les tirs s’intensifient, un blindé tombe en panne et force les soldats à s’enfuir à pied. Ils portent des casques bleus, et sont censés porter la paix. L’un d’eux tombe. La réplique alors se fait rageuse. Rude et aveugle, elle s’abat indifférente sur civils et miliciens. Le lendemain, dix-sept corps sont déposés devant le QG de la MINUSCA par des manifestants silencieux, enserrés dans des linceuls blancs. Parmi eux, des icônes du quartier, reconnus pour leurs exploits sportifs, des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés sans raisons par des soldats que leur hiérarchie dira avoir été « pris de panique ». Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU présent à Bangui ce jour-là, parlera « d’incidents » dont la responsabilité incombe aux hommes de Force, et exigera de ses hommes une surenchère meurtrière. Les casques bleus multiplient les interventions dans le quartier sans n’arriver à une quelconque de leurs fins. Les corps meurtris s’accumulent, l’indignation se généralise, jusqu’à provoquer une « dégradation critique » de la situation sécuritaire et politique dans l’ensemble du pays, que les équipes extérieures dépêchées par l’ONU dénonceront sans ambivalence dans leurs rapports internes.
C’est une de ces histoires dont une opération de maintien de la paix ne devrait pas se relever. Le seul 10 avril, trente-deux morts et cent quarante-cinq blessés, dont une immense majorité de civils, sont décomptés par la Croix-Rouge Centrafricaine. Quatre rapports de l’ONU à vocation interne sont produits dans la foulée : tous ont pour objectif d’exculper des casques bleus déjà dénoncés de toute part. Tous concluent à un usage « proportionné » de la force et au respect des règles d’engagement de l’ONU, face à des « mouvements militairement structurés et aux actions sophistiquées ». Alors que la polémique est relancée fin mai et que la pression s’accroît sur le secrétaire général adjoint, celui-ci commande un rapport monté de toute pièces par la division des droits de l’homme de la MINUSCA. L’objectif : se couvrir et exonérer définitivement des troupes rwandaises que leurs autorités menacent de retirer. Le 11 juillet 2018 M. Onanga-Anyanga, chef de la MINUSCA, s’exécute et balaye en trois pages « strictement confidentielles » toute faute, sur la foi du rapport produit par une équipe d’enquête conjointe de la MINUSCA où sont détaillés pas à pas les événements des 8 et 10 avril 2018. Celui-ci s’appuie notamment sur les rapports militaires du commandement des forces des opérations spéciales, dont plusieurs versions préliminaires furent échangées avec la hiérarchie avant que celle-ci ne les valide le 18 avril seulement, après avoir imposé sous différents prétextes de substantielles et gênantes modifications. Signés par le responsable adjoint des opérations spéciales Ikram Ul Haque et le lieutenant-colonel rwandais Jean Paul Ruhoraohza en charge de l’opération, ils ne laissent comme bien d’autres aucun doute à qui sait lire entre les lignes : au carrefour serpent, le 10 août, les casques bleus rwandais ont bel et bien ouvert le feu sur une foule désarmée, dont les deuxièmes et troisièmes lignes étaient d’apparence infiltrées par des miliciens qui n’avaient cependant pas fait usage de leurs armes.
La bavure, qui implique le premier peloton de FACA formé par l’Union européenne et encadré par les mercenaires russes, suite celle du 8 août, lorsqu’accompagnant les FACA, le peloton égyptien avait lui aussi fait usage de ses armes contre toute raison. Elles interviennent cependant dans un pays où moins de six correspondants étrangers, éloignés de leurs rédactions, exercent, dans des conditions d’insupportable précarité. Leurs articles, qui sont relus, validés et parfois censurés par des responsables régionaux n’ayant jamais mis les pieds sur place, sont rémunérés vingt dollars la pige pour le correspondant AFP, à peine plus pour celui de RFI. A eux seuls, ils sont chargés de la quasi-totalité de la production sonore, photographique et écrite qui sort du pays. Âgés de moins de trente ans, sans rapport avec le pays, n’étant pour la plupart jamais sortis de Bangui, ils connaissent là leur premier déploiement, et dépendent lourdement de sources officielles qu’ils sont pourtant censés traiter avec impartialité. Leurs rédactions attendent d’eux une production quotidienne qui, en cas de conflit avec les autorités gouvernementales ou l’ONU, deviendrait littéralement impossible. Louvoyant, tentant de respecter les principes d’une profession qui les maltraite, ils sont porteurs d’une responsabilité immense, de celles qui enflamment ou apaisent les cicatrices d’un pays. Dans la nouvelle économie des médias, dominée par des oligopoles qui captent l’ensemble de la valeur ajoutée, le journaliste ambitieux doit, pour débuter, faire le choix entre fait-diversier en province ou correspondant sans le moindre filet de sécurité à Bangui, Juba ou Jakarta.
Le 10 avril 2018 disparaissent trente-quatre corps et plus de cent blessés sans le moindre bruit. Le grand reporter d’un quotidien du soir, de passage entre deux pays exotiques, rapportera ce jour-là l’existence « d’incidents » dans la capitale, reprise mot-à-mot des éléments de communication élaborés par l’ONU. Mais il ne s’étendra pas. Au moment où les dix-sept cadavres enserrés dans des linceuls blancs étaient déposés devant la base militaire de l’ONU, le 11 avril 2018, par une foule clamant justice et exigeant le retrait d’une force qui concentre déjà plus du tiers des dénonciations pour violences sexuelles des opérations de maintien de la paix déployées par l’ONU dans le monde, un avion le ramenait d’une opération « embedded » auprès des casques bleus à Bangassou, où il s’extasiait du comportement de soldats en prise aux difficultés manifestes de leur mandat.
Le Centrafrique, ou République Centrafricaine, est un pays où l’on vit avec quatre-vingt-neuf centimes d’euros en moyenne, et où le moindre fonctionnaire international multiplie par cent ce revenu au quotidien2. Un pays où la quasi-totalité de la richesse est produite en sa capitale, où une superficie égale celle de la France est habitée de moins de cinq millions d’habitants. Où les recettes de l’État sont quatre mille fois inférieures aux nôtres3, et son PIB surpassé par les seuls bénéfices annuels de TOTAL. Un pays dont aucun chef d’Etat n’avait, jusqu’à l’élection du Président Faustin-Archange Touadéra, été intronisé ou déposé sans l’aval de l’ancienne puissance coloniale. La France.
Un territoire enclavé au Nord de l’Afrique des Grands lacs, enserré par les déserts du Tchad et du Soudan, la décrépitude des États de l’Afrique de l’Est, traversé d’une unique voie commerciale qui le relie aux économies précaires et bientôt désintégrées de l’Afrique de l’Ouest. La capitale, Bangui, est séparée de la République Démocratique du Congo par un mince fleuve, l’Oubangui, sur lequel donne l’ambassade de France. En ce lieu où se font et défont les pouvoirs du pays depuis l’indépendance, l’ambassadeur peut observer les épidémies de choléra et mouvements de guérilleros qui jonchent le Congo voisin, et entretenir un certain doute sur l’étanchéité d’une frontière traversée au quotidien par pirogues et pêcheurs à la corde. Il y a quinze ans, un certain Jean-Pierre Bemba embarquait ses troupes en cet endroit précis dans l’espoir de devenir le roi de la région. Depuis, potentats et hommes de paille se sont succédés. Le Président Touadéra, peu apprécié par la France, est menacé par le Président de l’Assemblée nationale, un certain Karim Meckassoua qui vient pourtant de disparaître trois mois, tandis que les groupes rebelles qui contrôlent plus de quatre-vingt pour cent du pays viennent d’être réunis à N’djamena sous l’égide de la France pour préparer la suite des événements. Jean-Pierre Bemba lui vient d’être exculpé par la Cour pénale internationale après près de dix ans de procédures, et s’apprête devenir le prochain président du pays voisin.
Pivot géostratégique, le Centrafrique, qui n’a jamais eu l’importance de la RDC, a longtemps été la clef de de voûte de la stratégie coloniale française en Afrique subsaharienne, le contrôle de ce territoire n’ayant jamais été qu’un moyen au service de luttes d’influence entre grandes puissances qui consument encore la région. Donnant accès au Congo Belge et au Rwanda Allemand, l’Oubangui-Chari servait de liant naturel entre les riches colonies de l’Afrique de l’Ouest et l’empire sahélien français. Zone tampon restée en jachère, ayant développé une identité nationale forte après l’indépendance grâce au travail de sape mené par son premier président, Barthelemy Boganda, et une centralisation économique et commerciale autour de sa capitale, le pays a par la suite vécu au rythme des affres d’un ancien officier de l’armée française, un certain Jean-Bedel Bokassa, empereur au prix d’une cérémonie ayant coûté le tiers du PIB du pays, avant de sombrer aux mains d’hommes de main placés par l’ancienne métropole, qui n’hésitèrent pas à donner à l’artère principale de la capitale le nom d’un Président français qui appréciait à légère déraison diamants, safaris et femmes d’un empereur bientôt déchu par ses forces spéciales pour s’être montré trop arrogant.
La suite a été une succession de déceptions. Le Centrafrique, malgré ses ressources naturelles, a souffert du désintérêt croissant de son ancienne puissance coloniale. La reconfiguration militaire opérée par Nicolas Sarkozy sur le continent a fait perdre à ce terrain de jeu pour barbouzes et néocolons en tous genre le peu de superbe qui lui restait. Dans le prolongement de la fermeture de la base militaire de Bouar, officiellement pour raisons d’économie, et du camp Béal, les troupes françaises se sont redéployées dans le Tchad voisin, à N’djamena, Abéché et Faya4. La base de M’poko, nom de la piste aéroportuaire qu’Air France dessert encore en vertu des accords d’indépendance, a vu les différentes opérations militaires déployées par l’ancienne métropole être remplacées par les forces de l’UA et les casques bleus de l’ONU. Pas à pas, les rares français qui exploitaient sucre, bois et coton se sont retirés, remplacés par les diamantaires libanais, les pétroliers russes et chinois, les circuits aurifères sahéliens et les gardes-forestiers américains. AREVA et Total, un temps installés à Bakouma et Birao5, se sont retirés dans la foulée. Le pays a perdu de sa centralité, et s’est ouvert à des capitaux étrangers rapaces, peu intéressés par l’investissement et beaucoup par la prédation.
La guerre civile de 2013 et le refus d’intervention de la France face à l’offensive de milices du Nord du pays a marqué un tournant majeur. Après l’effondrement du nouveau pouvoir incarné par Michel Djotodia, piètre successeur de Francis Bozizé, le pays a sombré en une période où même les préfets n’étaient plus nommés. Peu à peu, alors que les groupes rebelles prenaient définitivement le contrôle de la grande majorité du pays, les drapeaux russes remplacé les français. Et tout autour de la capitale, les regards se sont durcis. Jusqu’à la guerre civile de 2013, l’étranger recueillait encore un certain a priori d’estime, trouvant source en l’espoir que sa présence suscitait. Aujourd’hui, le mungiu est devenu source de mépris. Surpayé, entretenant une économie de la prédation, il est perçu comme le spoliateur de destins déchus de toute forme de souveraineté. La MINUSCA, son principal pourvoyeur, concentre toutes les haines. Elle a déployé 11 000 soldats et 2000 bureaucrates qui animent les nuits de Bangui. Censés stabiliser un territoire sans État, les népalais, gabonais, portugais, égyptiens et citoyens de plus d’une dizaine d’autres pays y vivent en surface, entre exploitation et cantonnement, dans l’attente d’une nouvelle affectation, violant, pillant et massacrant sans que jamais la moindre sanction sérieuse ne soit envisagée.
C’est dans ce cadre qu’une histoire qui aurait dû susciter le trouble est passée inaperçue. Il se trouve que les responsables, des casques bleus rwandais, sont déjà soupçonnés d’avoir traqué des réfugiés hutu jusqu’au plus profond du pays, mais que leur contribution est essentielle à la survie de la mission onusienne, dont dépendent bien des salaires, statuts et avancements. L’opération Sukula était censée démontrer à Jean-Pierre Lacroix, dont la visite avait été annoncée à ces dates précises, que le nouveau commandement avait repris les choses en main.
Il faut dire que le contingent gabonais, dont le retrait avait été annoncé, a été retenu in extremis après de longues négociations impliquant le Quai d’Orsay, alors que des accusations d’abus sexuels en masse, pouvant être qualifiés de crimes de guerre, venaient de faire surface à son encontre. Les six cent vingt-neuf casques bleus congolais venaient d’être renvoyés pour les mêmes raisons, après une première expulsion de cent-vingt soldats, après le retrait forcé des tchadiens, accusés de partialité et de soutien aux forces armées musulmanes du pays. L’ensemble du déploiement de la MINUSCA se trouvait menacé de mort, alors que l’opération Sangaris qui l’avait précédé avait été abandonnée en catimini au milieu de sévères accusations étayées de pédophilie organisée. Anders Kompass, l’employé de l’ONU qui avait révélé l’affaire, avait été suspendu puis exfiltré afin d’éteindre l’affaire, mais la chose s’était sue et une transition chaotique avait été mise en œuvre. La suite n’a pas été plus glorieuse. Le seul évêque du pays, proche du pape Ratzinger, pilier du dialogue interconfessionnel, claquerait la porte en dénonçant d’innombrables abus non sanctionnés à Bangassou, tandis que les cas d’exploitation sexuelle à Bangui se multipliaient. Dans ce contexte apocalyptique, qui aurait dû remettre en question la présence même des forces internationales, l’inertie bureaucratique a continué à se déployer pour s’assurer qu’aucun effondrement n’intervienne. Uruguayens, népalais et sénégalais ont pallié à chacune de ces défections massives et à la haine grandissante d’une population à laquelle personne n’a jamais demandé son avis. Les gouvernements successifs ont couvert les affaires, acceptant un statut quo qui permet à des ministres de toucher leur rémunération sans même prendre leur fonction. Les experts indépendants, démis ou expulsés dès qu’ils élèvent la voix, se succèdent tandis que les casques bleus sont devenues les cibles privilégiées de la population. Toujours plus distants culturellement et socialement, bunkérisés, les casques bleus se contentent en province de tenir leurs places fortes sans ne plus s’exposer, tandis que les embuscades et opérations commando se succèdent.
En ce contexte, le sentiment d’impunité s’est à ce point ancré que la MINUSCA et sa division des droits de l’homme a fini par devenir une machine à produire des rapports systématiquement à décharge pour les collègues avec qui sont partagés diners et nuits folles. Les enquêtes internes, dont celle de Mercedes Gervilla, n’ont servi tout au long de cette période qu’à blanchir l’organisation afin de la protéger, ou à dénoncer des complots d’ONG qui corrompraient des victimes afin de se faire valoir auprès des bailleurs de fond. Malgré des missions d’évaluation dépêchées par Genève et New York dont les conclusions sont accablantes, les rapports d’évaluation internes ne cessent d’exculper les forces sur place, dénonçant la « culture de haine » alimentée contre l’ONU par les journalistes osant émettre des critiques, dont ceux de RFI. Dans le même temps, les missions parallèles, censées renforcer les institutions nationales, se multiplient. Les experts dépêchés par le siège se succèdent. Rémunérés cinq-cents dollars la journée, ils produisent des rapports stéréotypés à l’égard d’institutions inexistantes au sein de pays qu’ils n’ont jamais parcouru, dévorant la capitale d’une inflation qui rend impossible la moindre obtention d’une nuitée pour moins de trois PIB annuels par habitant. L’auberge espagnole d’un pays où les salaires à six chiffres des humanitaires et fonctionnaires internationaux pourrissent jusqu’à la moelle les rapports avec la population locale ne se distingue plus en rien du système colonial d’antan. Les boîtes de nuit s’emplissent de figures oniriques que la médiocrité blanchie saisit au quotidien. La fin de l’aide bilatérale, au profit de fonds multilatéraux, aurait au moins dû permettre, face à cette gabegie de parer aux principales urgences humanitaires6. Elle s’est transformée en perfusion permanente qui laisse la population sans prise sur son réel et oblige ses regards à une forme de faïence.
Alors, lorsque, pour impressionner le secrétaire général adjoint, un nouveau commandant de la MINUSCA a décidé d’une opération de maintien de l’ordre, dénommée Sukula, censée désarmer une milice locale qui protégeait l’enclave musulmane de Bangui, et que les choses ne se sont pas passées comme prévu, personne n’a réagi. La population a pris les armes, ou plutôt les pierres qu’un sol jamais bétonné ont laissé se multiplier, sans comprendre pourquoi elle le faisait7, des milices hier dénoncées par des populations las d’être exploitées se sont jointes à elle, et rapidement se sont mis en place les conditions d’un massacre que personne n’a cherché à comprendre, justifier ni éviter. Les FACA, infiltrées par ceux-là même qu’ils sont censés combattre, avaient révélé les détails d’une opération imminente aux miliciens de Force, précipitant un drame que personne n’a osé assumé. Le village Potemkine, qui s’était effondré dès le 8 avril, lorsque, alors qu’ils pensaient tomber sur une cache d’arme, les casques bleus avaient été enserrés par une population furieuse armée de pierres et de bâtons, a connu un nouvel échec. Des jours d’enfer ont suivi, jusqu’à ce que ce 10 avril, femmes, enfants et idoles locales ne périssent instrumentalisés. Les jours suivants, des dizaines de corps « impossibles à identifier » par les agents de l’ONU, continueraient à affluer dans les morgues, sans que personne n’envisage d’arrêter une opération dès le départ échouée.
A quelques centaines de kilomètres de là, le proto-état constitué par le FPRC, ancienne colonne vertébrale des Séléka, s’était réuni et appelé en urgence l’ensemble des forces rebelles à préparer une prise de Bangui. Nourredine Adam avait consulté ses pairs de l’UPC et du MPC, demandé l’appui de la France. Les Mirages stationnés au Tchad avaient été en réponse déployés et, par leurs survols à basse altitude, évité le pire. Mais quel pire ? Le remplacement d’un pouvoir fantoche par un autre, la reproduction du drame de 2013, où par irritation, la France avait laissé tomber son ancien allié au profit d’une force hétéroclite qui n’en attendait pas tant, surprise d’avoir si facilement pris la capitale, se laissant couler de pillages en violences anarchiques, jusqu’à un effondrement par tous anticipé ?
La France avait laissé faire, après avoir promis qu’elle n’interviendrait pas. Cette fois aussi, l’élément de langage est rodé. L’ambassadeur le dit et le répète tandis que son collègue tchadien réunit les forces rebelles à N’djamena, et que son premier conseiller montre la nouvelle carte d’un pays où figurent les déploiements massifs d’ONG forestières contrôlées en urgence par la CIA pour contrer l’influence grandissante des mercenaires russes venus profiter d’une exemption octroyée par le Conseil de sécurité pour prendre le contrôle du pays. La France, qui est pen holder à ce sujet à New York, a étrangement laissé faire. L’on sent les effectifs sur place relativement démobilisés. Le pré-carré longtemps inatteignable, qui déjà permet à tous de lorgner sur la République Démocratique du Congo, n’est plus8.
Pourtant, une influence en chasse l’autre. Déjà les premiers scandales touchant les mercenaires de la division Wagner, que l’on soupçonne d’avoir commandité l’assassinat sauvage de trois journalistes d’investigation russe venus enquêter sur la présence de leurs congénères en ce nouveau pays. Bientôt la garde rapprochée du Président Touadera dirigée par un certain Valery Zakharov et qui avait remplacé les sud-africains recrutés par Bozizé pourrait être remplacée par les forces spéciales françaises venues en appui de la rébellion du Nord. Dans l’entre-temps, quelques marchands de rêve profiteront du creux pour vendre à peu de frais leur intermédiation et vanter les ressources inexploitables du pays, et des représentants de M. Erik Prince, fondateur de Blackwater, la société américaine de mercenaires, se laissent voir dans le seul hôtel de luxe de la ville. Le Centrafrique, ce pays qui n’existait pas, continuera ainsi, infatigable, à subir la logique d’un système international qui ne peut se permettre de laisser un quelconque territoire sans souveraineté formelle, et qui pourtant semble se désintéresser des territoires qu’il a artificiellement structuré. Dans ces limbes où l’espérance de vie se négocie au prix de silences toujours plus coupables, les populations passent insensibles d’une domination l’autre, laissant les forces coloniales devenues multilatérales peupler leurs nuits sans regimber. Au loin les metteurs en scène du drame continuent eux de fomenter l’incompréhension des opinions publiques occidentales, alternant les déclarations catastrophistes et désolées face à ces pays qui, tels Haïti ou la Somalie, ne savent décidemment aller que de désastre en désastre.
ENCADRÉ
Si la MINUSCA a lancé officiellement quatre enquêtes sur les faits intervenus à PK5, aucune n’a débouché sur la moindre sanction ou reconnaissance de culpabilité, et aucun commandant n’a été relevé. Les documents confidentiels auxquels nous avons eu accès, produits par l’UNPOL, le DKPO, une équipe conjointe d’enquête de la MINUSCA et la police militaire, confirment tous que l’opération Sukula a provoqué la mort de plus de cent personnes et blessé plusieurs centaines de civils sans n’atteindre le moindre de ses objectifs, dégradant sévèrement la situation politique et sécuritaire du pays. Tous pourtant concluent à l’absence de violation des règles de l’ONU. L’impunité organisée par une bureaucratie devenue machine à blanchir n’a qu’un objectif : préserver les carrières et des contingents difficilement arrimés à une mission à laquelle personne ne souhaite se joindre, et qui menace en permanence de s’effondrer. Dans ce cadre délétère, est entrée en fonctions en juin dernier la Cour pénale spéciale, institution hybride mêlant droit Centrafricain et international, dont l’objectif officiel est de mettre fin au règne de l’impunité. Après trois ans d’inactivité, et alors que son budget représente un treizième des recettes de l’État centrafricaine, sa gestion opérationnelle a été confiée à… la MINUSCA, qui s’est promptement assurée auprès des experts indépendants qu’elle a recruté pour élaborer la stratégie de son Procureur que les accords d’immunité s’appliqueraient bien à ses propres forces. Son premier procureur, le congolais Toussaint Muntazini, est non sans hasards bien connu pour avoir « monté » l’opération Germain Katanga avec la Cour pénale internationale. Alors Procureur militaire en République Démocratique du Congo, il avait organisé l’extradition de ce jeune milicien de vingt-six ans, nommé général la veille de son arrestation, à La Haye, dans le cadre d’une opération montée de toutes pièces par le Président Joseph Kabila avec la complicité du fantasque Procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. Neuf ans de procédure avaient été nécessaires pour que la CPI admette que M. Katanga n’avait été qu’un lampiste, pris dans un jeu de dupes visant à permettre à l’institution de « faire tourner la machine » et à Kabila de complaire à la communauté internationale. Condamné à un reliquat de peine qui sauvait la face de l’institution, Germain Katanga avait été libéré dans la foulée et… transféré à Kinshasa où il serait immédiatement embastillé. L’opération, rondement menée, permettrait à Toussaint Muntazini d’entamer sa carrière internationale d’être nommé à la CPS où, doté d’une douzaine d’officiers de police judiciaire, encadré par la MINUSCA et appuyé par des juges d’instruction internationaux menant grand train, il n’a depuis sa nomination en février 2017 lancé la moindre enquête dans un pays où le désir de justice se fait pourtant patent, et où les premiers procès contre des criminels de guerre menés en janvier 2018 par la justice nationale ont suscité un grand retentissement.
1 Selon les premiers éléments de langage énoncés par la France afin d’obtenir la résolution du Conseil de sécurité autorisant son intervention, les musulmans, qui constituent moins de 20% de la population du pays, auraient présenté un risque génocidaire envers les populations chrétiennes du pays. La disproportion des forces en présence, l’absence de conflictualité structurelle entre communautés religieuses, d’historicité des conflits, d’infrastructures et d’armement appropriés pour l’organisation d’un tel projet, d’intention même, la densité extrêmement faible du pays et finalement l’inexistence d’un quelconque début de preuve allant en ce sens ne suffirent pas à éviter que ce discours se trouve repris unanimement par la presse française pour justifier l’intervention armée.
2 Selon la Banque mondiale, le PIB moyen par habitant était de 382 dollars en 2016. 3 130 millions en 2017, hors aide extérieure.
4 Bases d’appui de l’opération Epervier au Tchad 5 Voir article Monde diplomatique, Bakouma…
6 L’espérance de vie à la naissance est ainsi passée de 44 ans en 2002 à 52 ans en 2016. Elle reste la plus basse au monde selon la Banque Mondiale, et 110 enfants souffrent encore de malnutrition aigue en 2018.
7 La rumeur de l’enlèvement, instrumentalisée par les milices locales, permettant de déjouer l’opération préparée conjointement avec les russes.
8 175 instructeurs et près de 8000 armes ont pour l’instant atterri, tandis qu’un accord de coopération militaire était signé avec la République démocratique du Congo et que la garde présidentielle de Touadéra était confiée à Valery Zakharov. Des groupes de mercenaires se laissent voir dans la capitale tandis que des concessions d’exploitation minières ont par ailleurs commencé à être octroyés.