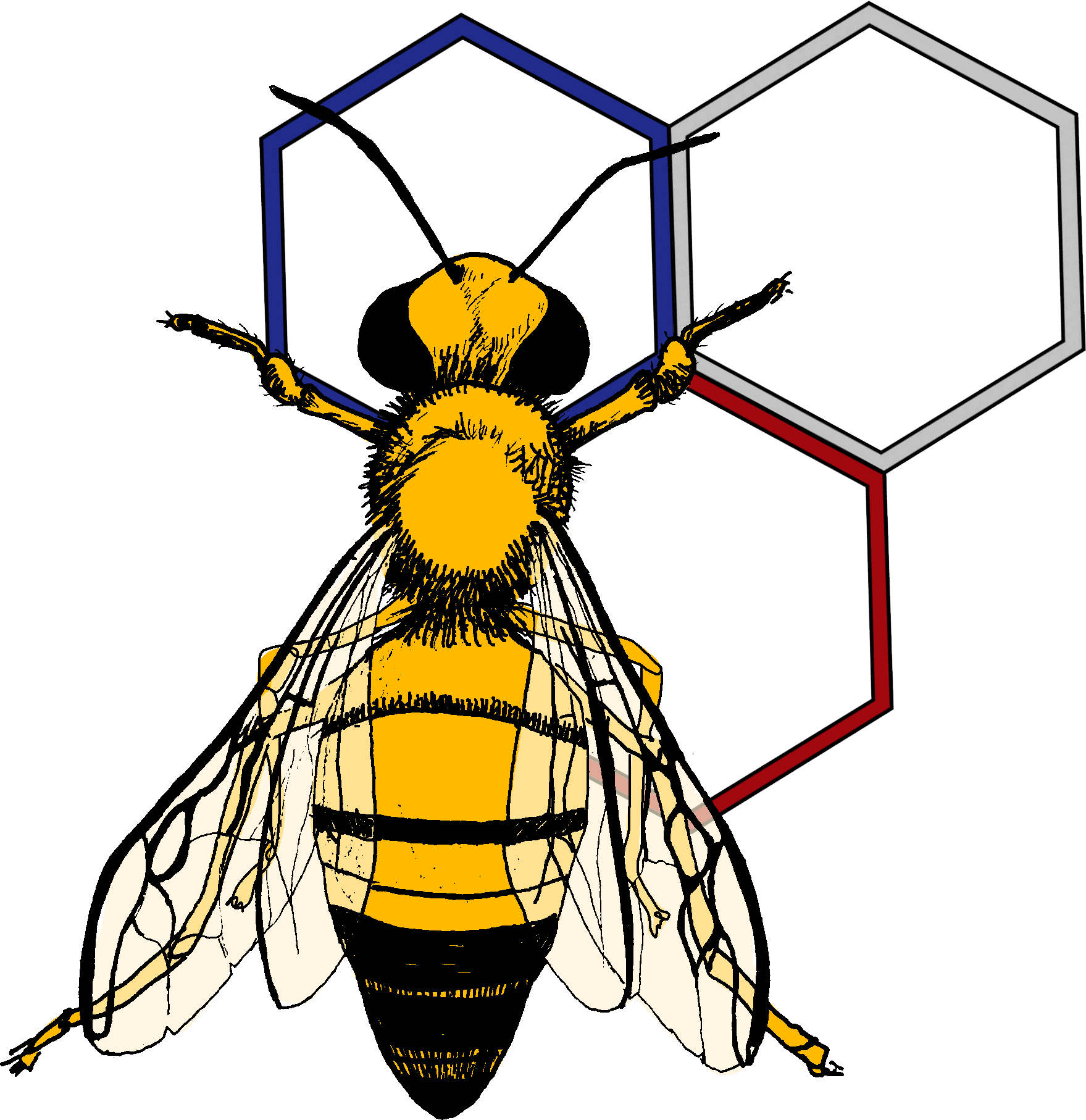SOKOUROV ET L’HUMANISME, UNE AFFAIRE DE CADRE
Libre, il faut avoir senti le cadre.
Dans un entretien avec les Cahiers du Cinéma (novembre 2015, n°716), le réalisateur russe Alexandre Sokourov défend Pétain au nom d’une certaine idée de l’humanisme :
« Pour moi, la décision historique de Pétain a été bonne pour la France. Il y avait beaucoup de circonstances morales très dures, mais c’était une position justifiée. Plus de vies humaines ont été sauvées de cette manière. Le film part de ça, de cette balance : quel est le prix de la vie humaine ? Pendant que vous pouviez aller au café à Paris, les Russes mouraient en masse. Peut-être qu’on est morts pour cela d’ailleurs, pour Paris et pour la culture. Mais personne ne nous a dit merci (…) Au cours des huit premiers mois, trois millions de Russes ont été tués ou faits prisonniers sur le front de l’Est. Mais on ne peut pas dire qui est coupable. Le choix de Pétain, sa décision de trouver un compromis, était sans doute très dure mais aussi plus humaniste. Toute décision humaniste a un versant moral compliqué ».
On serait tenté de dire que M. Sokourov a parfaitement raison. L’humanisme de Pétain dans son refus de livrer à la mort des millions de français est, dans une perspective littérale, incontestable, et toute décision humaniste a un versant moral compliqué. Mais nous serions tentés de le dire pour préciser aussitôt que M. Sokourov ne peut avoir raison que dans un certain cadre, un cadre ancien, oublié, qui nous apparaît à sa lecture étranger, cadre qui est celui de la nation, cadre qu’il adopte d’ailleurs explicitement, par l’utilisation régulière du « on » renvoyant à ses compatriotes russes (« Peut-être qu’on est morts pour cela d’ailleurs »).
Sauf que l’on se rend vite compte – immédiatement, intuitivement, par analogie à cette idée de cadre – que M. Sokourov ne peut avoir tout à fait raison, parce que le cadre dont il parle, dont il part, la nation, n’existait alors pas, puisqu’elle ne respectait pas ses promesses – son propre discours – et excluait ceux qui lui appartenaient légitimement, tout un pan de la population, les juifs bien entendu, et les autres victimes de la politique nazie, sans que rien ne justifie ce geste.
M. Sokourov est cinéaste, au sens plein du terme, c’est-à-dire un cinéaste cadreur. Il sait très bien ce qu’un décalage entre la pensée et l’image, un dérapage, coûte au cadre : sa disparition.
Les Cahiers du cinéma sont une revue de cinéma au sens plein du terme, c’est-à-dire sachant cadrer. Ainsi l’entretien avec M. Sokourov est-il élégamment dénué de toute introduction, de tout chapeau et de tout titre, se contentant pour ouverture d’une citation sans guillemets et d’un petit sous-titre qui distingue à peine l’entretien de la critique de Cyril Beghin s’achevant sur la même page. Rien n’appelle à l’entretien pour le lecteur qui feuillette, et celui-ci tombe dessus sans se rendre tout à fait compte qu’il s’agit là d’un dialogue avec un grand cinéaste, qui a pourtant fait suffisamment oeuvre pour mériter une mise en exergue similaire à celle dont bénéficie M. Morretti, quelques pages plus loin, dans le même numéro.
Cela n’est pas un hasard. Les Cahiers du cinéma se savent peu lus, et s’imaginent bien lus. Ils n’ont dès lors pas peur d’introduire une pensée fasciste dans leur cadre, parce qu’ils pensent qu’ils sauront l’encadrer, et que leurs lecteurs sauront regarder dans ce cadre, pour s’assurer de sa justesse. Ils n’ont dès lors pas besoin de rappeler les rapports de M. Sokourov à Poutine, en guise d’avertissement ou de contextualisation, ni d’interroger le cinéaste sur ces liens. Ils n’ont pas besoin, en somme, de créer une distance artificielle avec l’entretenu – bien que M. Béghin ait l’élégance de le reprendre sans contestation possible, mais sans fermeture possible, à la troisième mise en absence de la question juive dans leur dialogue. Cela, parce que les Cahiers du cinéma, forts de leur Histoire et de leur expérience, savent parler à un grand réalisateur, et, suivant en cela une longue tradition, le laisser se tromper.
Ce qui se joue là, dans ces quelques lignes, entre M. Sokourov, et son fascisme, M. Beghin, les Cahiers et leurs lecteurs, est donc est une affaire de confrontation de regards qui se savent savoir voir, et qui agissent en conséquence. M. Sokourov sait que l’on sait – à défaut de penser que l’on sait regarder. Mais il sait plus encore la force de son regard et de sa capacité à cadrer – et dès lors à façonner notre idée du Savoir.
Il n’est dès lors pas dû à un hasard que pas un mot ne soit dit de sa part sur les juifs, sur l’antisémitisme de Pétain et celui qu’on lui soupçonne – et nous parlons d’antisémitisme en ce que ce terme englobe de rapport aux minorités un jour sorties du cadre, des juifs aux roms en passant par les homosexuels (l’homophobie latente de M. Sokourov, qui abonde, par effet de système lié à ses inclinaisons idéologiques et au système dans lesquelles elles s’insèrent, aux soupçons d’antisémitisme, s’exprime d’ailleurs en fin d’entretien, par un rajout d’homo à ce qui aurait dû, pour être recevable, rester seulement sexuel). Pas même lorsque Cyril Beghin tente de les réintroduire dans le cadre, alors que leur absence se fait béante.
Il n’y a bien entendu là rien d’insignifiant, et cela M. Sokourov le sait. Car en les décadrant, en maintenant silence sur l’évidente image manquante de son raisonnement, il effectue le même geste que fit M. Pétain en son temps, et il le fait probablement avec la même intentionalité, celle qui l’amène à le défendre contre l’évidence : les sortir du jeu et les livrer, plus qu’à la mort, à la disparition.
Le cadre est ce qui relie le politique à l’esthétique, leur seul point commun. En décadrant comme le fit M. Pétain, M. Sokourov ne fait au final que mettre en œuvre le geste principiel, fondateur du cinéma. On pourrait alors penser qu’il ne fait que souligner le lien profond entre cinéma et politique, et donc entre le cinéma et la politique dans son sens le plus fort, le fascisme. On pourrait s’en tenir là, se satisfaire de cet exercice critique. Sauf que ce serait là faire l’impasse sur le véritable problème de ce silence : le surcadrage qu’opère M. Sokourov, et dès lors, son manque de goût. Sa faute esthétique.
Expliquons-nous : en soirée mondaine comme au cinéma, le manque d’élégance s’explique le plus souvent par le refus de la prise en compte d’un autre, d’une altérité. Il est le plus souvent associé à une absence de pensée – on a oublié de penser que ceci pouvait blesser celle-là, on a oublié de penser à l’autre plus généralement, on a oublié de penser tout court. Ce manque d’élégance – cette non-prise en compte de l’autre – parcourt toute pensée qui se livre à l’essentialisme, essentialisme que l’on pensait disparu de notre pensée, mais que M. Sokourov fait resurgir au cœur d’un des cadres structurants de notre pensée, les Cahiers du Cinéma, par empilements successifs qui finissent par faire sens (homosexualité, judaïté par absence, nation). Il contamine quiconque s’y livre – Heidegger et les juifs bien entendu, mais aussi Deleuze et les anglais ne sachant philosopher – et désactive immédiatement (souvent temporairement) toute recevabilité de leur pensée.
Le manque d’élégance, c’est une chose devenue a priori futile dans nos sociétés, un dérapage qui n’importe guère, tant il semble par ailleurs se généraliser : qu’importe qu’ici ou là disparaissent temporairement du cadre immigrés, homosexuels ou juifs, ce n’est qu’un oubli secondaire, lié à une trop grande intensité passagère, qu’ils nous pardonneront bien. Qu’importe que l’on décadre ou que l’on oublie son cadre ici et là : qui n’en ressent jamais le besoin ?
Il en va de même au cinéma, où le sur-cadre et le hors cadre semblent, de pair s’être généralisés. Comme si une perte commune, brutale, radicale, de références, se révélait là, par l’incapacité à peser, à tenir un discours par l’image qui trouverait un point d’équilibre, dénoterait une cohérence, un raisonnement tenu et alimenté. Tenu, pour éviter le hors-cadre, celui qui révèle, par l’incapacité à imposer une tension, l’absence de pensée. Alimenté, pour éviter le sur-cadre, pour, par le maintien d’une ouverture aux influx extérieurs, éviter la domination de la pulsionalité, de la névrose la plus sèche, maintenir un rapport au monde et au réel là où tout amènerait à se renfermer, et ainsi, pouvoir maintenir cette caractéristique fondatrice du cinéma, son caractère social, de partage – et que l’on ne s’y trompe pas, le discriminant est justement la clef, le fondement du social, tant qu’il est justement utilisé comme critère recevable, universalisable au-dehors des conditions diverses, et non comme excluant ontologique, essentialiste.
On s’étonne dès lors que les Cahiers ne le signalent pas, n’opèrent pas de recadrage – pas seulement par une question facilement ignorée, mais par ce qu’appellerait tout propos similaire, c’est-à-dire une remise à plat entière de notre regard sur l’œuvre de M. Sokourov à partir de ce manque d’élégance – de ce trou dans la pensée. Peut-être les Cahiers pensent-ils que ce dernier ne parcourt pas les œuvres de M. Sokourov, et que que cela pardonnerait tout. C’est à la fois vrai, M. Sokourov a l’élégance de ne pas nous infliger ses absences de pensée dans les textes de ses œuvres, et faux : M. Sokourov est un cinéaste qui a tendance à surinvestir les cadres, problème que l’on aurait pu jusqu’ici qualifier de formel. Or on l’a vu, le problème des pensées qui ontologisent le monde, des essentialismes, est bien parfois qu’ils surinvessent leur propre cadre jusqu’à ne plus y voir qu’eux-mêmes, comme l’élégant mondain qui, oubliant que son comportement n’a de sens qu’en ce qu’il a une destination, le rapport à l’Autre, finirait absorbé par son miroir. Un phénomène que les Cahiers n’avaient pas manqué de relever à ses origines, lorsqu’ils s’érigèrent contre une certaine Qualité française et qu’ils firent naître, par ricochet, une morale du plan successivement investie par trois de ses plus sain(t)s contributeurs, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et Serge Daney, à partir de textes qui avaient tous quelque peu à voir avec la question du fascisme et de son humanisme, et que l’on s’est un peu efforcés d’oublier depuis. Tout ceci n’est peut-être pas un hasard*.
Juan Branco, pour la revue Débordements (octobre 2016)
*On avait commencé ce texte en pensant régler son compte à la pensée humaniste, pensée sans cadre par excellence (parfait miroir de l’essentialisme) – caractère que M. Sokourov sent sans l’admettre ni en tirer les conséquences, car ce serait alors s’imposer de rejeter cette précieuse béquille, lorsqu’il souligne à raison son inextricable ambivalence – et dès lors naturellement étrangère au cinéma. Gageons que, pour les esprits les plus cadrés, cela a été fait.
(1) Elles atteignent les 3 micro-sieverts par heure (μSv/h), alors qu’elles ne dépassent pas autour du village 0,08 μSv/h.
(2) « Jim Mellon interview », Spear’s WMS Magazine, no 13, février 2010.
(3) « French nuclear frontrunner’s toxic political dealings in SA », Mail & Guardian, Johannesburg, 3 août 2012.
(4) Cf. « La nouvelle guerre sale pour l’uranium et les minerais d’Afrique », dossier de WikiLeaks, 5 février 2016, et le roman d’espionnage de Vincent Crouzet Radioactif, Belfond, Paris, 2014.
(5) « Areva, 3 milliards en fumée », « Pièces à conviction » du 10 décembre 2014, sur France 3.
(6) « Rapport d’activité sur la mine de Bakouma et Areva », WikiLeaks, 5 février 2016.
(7) « Areva & UraMin, la bombe à retardement du nucléaire français », Arte, 14 mai 2015.
(8) MM. Marc Eichinger et Mario Brero.
(9) « Areva : les secrets d’une faillite », « Pièces à conviction » du 19 octobre 2016, sur France 3.
Lire aussi les courrier des lecteurs dans nos éditions de novembre 2016 et de janvier 2017.